Panneau latéral
Ceci est une ancienne révision du document !
HISTOIRE DES REPRESENTATIONS DE L’ORIGINE DU LANGAGE ET DES LANGUES
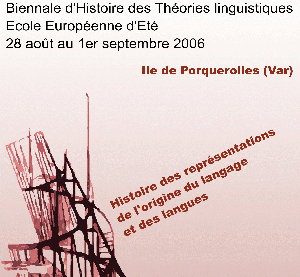 Ile de Porquerolles
Ile de Porquerolles
Du 28 août au 1er septembre 2006
- Présentation
- Programme / Documents / videos
- Objectifs de l'école
- Comités, Liste des intervenants, Modalités pédagogiques
Présentation
Cette école est organisée par le laboratoire d’Histoire des Théories Linguistiques, avec la collaboration de l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle, et avec le soutien du CNRS, du MEN, de l’Université Paris 7, de la Frei Universität, Berlin (Allemagne) et de l’Université d’Illinois, Urbana-Champaign (U.I.U.C.), USA
Public concerné :
Chercheurs, enseignants-chercheurs et ITA en linguistique, histoire des théories linguistiques, histoire des sciences, histoire, philosophie, sciences cognitives, anthropologie, paléo-anthropologie, génétique…
Etudiants de troisième cycle, français ou non, en : histoire des théories linguistiques, linguistique, histoire, histoire des idées, philosophie…
Enseignants de français, histoire, philosophie, biologie …
GRANDS AXES DU PROGRAMME
Cette Université d’été souhaiterait apporter sa contribution critique à la question de l’histoire des représentations de l’origine du langage et des langues :
- en restituant une part de son empan historique
- en redonnant au débat l'ampleur d'un argumentaire le plus souvent aujourd'hui «simplifié» à l'extrême (au détriment, il faut le dire, du point de vue de l'anthropologie historique)
- en ne limitant pas l'enquête aux traditions linguistiques « occidentales » - les moins «mal» connues
- en faisant une place à l'histoire des représentations sociales et individuelles, imaginaires, religieuses, littéraires et idéologiques de la « scène primitive » de l'origine du langage et des langues, pour mesurer son incidence - souvent occultée - sur le débat scientifique (y compris actuel).
Nous souhaitons insister particulièrement sur la variabilité historique des représentations de l’origine du langage et des langues ainsi que sur les permanences de cette thématique au cours de l’histoire. Le terme représentation, contenu dans notre titre, souligne le fait qu’aujourd’hui comme hier, l’élaboration de scenarii de l’origine du langage et des langues ne se laisse pas enfermer dans une conception étroitement « positive » de la science.
Programme
Film d'introduction vidéo introduction
Lundi 28 août 2006 Le roman des origines
9h30 - 10h00 S. Archaimbault : Présentation de l’Ecole d’été vidéo introduction
10h00 - 11h00 Cours d'ouverture : Représentations imaginaires, mythiques, sociales de l’émergence du langage
11h30 - 12h30 Ouverture des trois ateliers de formation
A) Origine du langage et religions du livre : récits fondateurs
S. Kessler-Mesguich, I. Rosier-Catach, D. Kouloughli, J.L. Chevillard
B) Origine du langage et religions du livre : l’hébreu plus ancienne langue conventionnelle ?
J. Olszowy-Schlanger (l’origine du langage chez les grammairiens caraïtes, Xe-XIe siècle), A. Grondeux (l’épisode de Babel interprété dans le Moyen Age occidental : grammairiens, exégètes, historiens)
Synthèse atelier A
C) Mythes d’origine et imaginaire individuel
M. Decimo (le cas Jean-Pierre Brisset), J. J. Courtine (glossolalie )
Synthèse atelier C : J. J. Courtine
Synthèse atelier C : M. Decimo
14h - 16h Poursuite des trois ateliers
16h - 18h Pause - temps libre
18h - 19h Synthèse des travaux des trois ateliers dans la grande salle
21h - 23h Table-Ronde : Unité, diversité et multiplicité des langues dans les représentations de l’origine
Président : J. Trabant, avec : J. L. Chevillard, M. Decimo, J. J. Courtine, A. Grondeux, S. Kessler-Mesguich, D. Kouloughli, J. Olszowy-Schlanger, I. Rosier-Catach vidéo introduction
Mardi 29 août 2006 Diversité et stabilité des enjeux de la question de l’origine
9h30 - 10h30 Cours : S. Auroux : L’interdit de la société de Linguistique de Paris (140 ans après)vidéo introduction
11h00 - 12h30 Ouverture des trois ateliers de formation
A) Nature/ convention, le signe et son arbitraire
Marie-Luce Demonet (Nature/ convention, le signe et son arbitraire à la Renaissance), M. Baratin, R. Petrilli (Nature/ convention, le signe et son arbitraire dans l'Antiquité)
Synthèse atelier A : R. Petrilli lire la suite
Synthèse atelier A : M. Baratin lire la suite
B) La notion de proto-langue : émergence et évolution
Animation : Charles de Lamberterie
C) Les scénarios de l’origine aux 17 e et 18 e siècle
V. Raby, M. Pécharman
Synthèse atelier C lire la suite
14h - 16h Poursuite des trois ateliers
16h -18h Pause - temps libre
18h - 19h Synthèse des trois ateliers dans la grande salle
Mercredi 30 août 2006 Origine du langage, changements linguistiques et reconstruction
9h30 - 10h30 Cours : C. Puech. : Mythe, histoire, genèse : modèles de l’origine vidéo introduction
11h00 - 12h30 Ouverture des trois ateliers de formation
A) Histoire de la créolistique
Animation : D. Véronique et A. Kihm lire la suitelire la suitelire la suitelire la suite
Synthèse atelier A lire la suite
B) Représentations des origines et stabilisation grammaticale
M. A. Mahieulire la suite, C. Rodriguez-Alcala
C) Origine des langues et typologie linguistique
François Jacquesson lire la suite lire la suite
14h - 16h Poursuite des trois ateliers
16h - 18h Pause - temps libre
18h - 20h Synthèse des travaux des trois ateliers en amphi et Table-Ronde : Reconstruction et origine du langage, avec : Ch. De Lamberterie
Jeudi 31 août 2006 Instituer les langues
9h - 10h Cours : D. Kibbee : les « modes d’institution » des langues et des faits linguistiques vidéo introduction
10h30 - 13h Deux ateliers de formation
A) Les enjeux des langues universelles dans la période contemporaine
S. Archaimbault lire la suite (Langues universelles, internationalisation des langues et traduction automatique, Grande-Bretagne et URSS)
J. Léon lire la suite (Langues universelles, internationalisation des langues et traduction automatique, Grande-Bretagne et URSS)
J. M. Fortis lire la suite (du langage mental aux structures sémantiques conceptuelles)
D. Savatovsky lire la suite (de l’hyperlangue à l’interlangue : caractéristiques universelles et langues internationales auxiliaires - 1880-1948)
Synthèse atelier A lire la suite
B) Terminologie, planification, interventionnisme
D. Candel, D. Kibbee lire la suite
13h00 - 18h15 Déjeuner - activités culturelles
18h15 - 19h00 Synthèse des travaux des deux ateliers dans la grande salle
21h00 - 23h00 « Le grand atelier » : Grammatisation des vernaculaires, diversité linguistique et représentation de l’origine. Animation collective, avec :E. Orlandi lire la suite, B. Colombat lire la suite, J.M. Fournierlire la suite, M. Breva-Claramonte lire la suite (la tradition des grammaires de missionnaires), D. Kouloughli
Vendredi 1er septembre 2006 L’origine aujourd’hui : une nouvelle synthèse ?
9h00 - 10h00 Conférence : J. Trabant : Origine du langage, origine et diversité des langues vidéo introduction
Débat de clôture : Quoi de neuf dans la question de l’origine du langage et des langues ?
Président : B. Victorri, avec :
10h30 - 11h15 S. Auroux vidéo introduction
11h15 - 12h00 B. Victorri vidéo introduction
Débat de clôture (suite) : Quoi de neuf dans la question de l’origine du langage et des langues ?
Président : S. Fisher, avec :
13h45 - 14h30 S. Auroux
14h30 - 15h15 R. Nicolaï lire la suite
15h15 - 16h45 Débat
Synthèse finale de l’Ecole
Objectifs de l'école
OBJECTIFS SCIENTIFIQUES
Cette école thématique propose une réflexion sur l’articulation des sous-disciplines à l’intérieur de la linguistique (phonétique, morphologie, syntaxe, traitement de corpus, recours à l’imagerie, appareillages…). En collaboration étroite avec les chercheurs impliqués dans le développement d’une linguistique expérimentale, cette école thématique permettra de mettre en relations différentes spécialités et de mener de concert une réflexion épistémologique informée sur le plan historique. En retour, elle sera l’occasion pour les historiens et épistémologues de se confronter à la science en train de se faire.
C’est une certaine conception de l’unité des sciences du langage qui est ici en cause sous l’angle de la méthode, et, au delà, la question du rapport à « l’empirie » concerne philosophes et épistémologues, ainsi que l’ensemble des sciences de l’homme.
Cette école thématique entend accompagner sur le plan de l’épistémologie historique, un projet novateur reconnu (LABEX EFL Empirical Foundations of linguistics) pour proposer un « développement intégré de la totalité du spectre de la recherche en linguistique, depuis les problèmes posés par la production phonologique, jusqu’à la complexité de la grammaire à travers un corpus d’une centaine de langues ». Qu’est-ce qu’un « laboratoire » en linguistique ? Une linguistique de laboratoire ?
Les objectifs scientifiques de l'école sont de :
Mettre en rapport des secteurs de la recherche en linguistique qui s'ignorent le plus souvent dans le travail quotidien (linguistique formelle, linguistique expérimentale, histoire de la linguistique, Traitement Automatique des Langues, philosophie du langage, psycholinguistique, linguistique de terrain, etc).
Inciter les chercheurs et les enseignants-chercheurs, mais aussi les étudiants avancés, les doctorants et les jeunes chercheurs à intégrer une démarche réflexive.
OBJECTIFS DE FORMATION
Le dispositif aujourd’hui éprouvé (quatrième édition depuis 2004) fait alterner cours, ateliers de formation et travaux de synthèse. Ce dispositif laisse une large place aux discussions et échanges. La formule « résidentielle » assure une proximité féconde entre des « acteurs » qui sont aussi « publics », et réciproquement a l’avantage d’associer étroitement dans la réflexion chercheurs et enseignants confirmés et doctorants et jeunes chercheurs. Il s’agit d’un dispositif de formation à la recherche.
La formule pédagogique consiste en un dispositif de mutualisation des connaissances et des méthodes qui dépasse les spécialisations en les impliquant. Dispositif de « formation à la recherche et par la recherche » sur un temps court (mais intense), elle permet une participation active de tous: chercheurs confirmés ou débutants, étudiants en formation, collègues aux statuts divers, curieux avides…
- Diffusion synthétique des connaissances
Le « dispositif Université » permet à la fois, par son caractère interactif, la diffusion de connaissances et l'ouverture éventuelle de perspectives quant à la production commune de savoirs nouveaux. L'alternance quotidienne entre cours et synthèses qui réunissent l'ensemble des participants en début et fin de journée et ateliers qui les distribuent en fonction de leurs centres d'intérêt, constituent un dispositif contraignant mais fécond.
- Mise en forme problématisée des acquis
Grâce à la participation active des organisateurs, intervenants et participants (nous souhaitons que tous les intervenants soient également participants, et soient présents sur les lieux pour toute la durée de l’Université d’été), la réflexion autour des grands thèmes choisis devrait s’enrichir notablement et pouvoir faire à son tour l’objet d’une diffusion à un public plus large sous forme d’ouvrage et de support multimédia. Les « synthèses » des fins de journées et de fin de semaine donnent l'occasion aux doctorants de mettre en forme « sur le terrain » et pour autrui les acquis et problèmes du jour. La restitution des travaux en fin de semaine sera l’occasion pour les doctorants de présenter les acquis sous la forme de power point réalisé autour des thématiques.
- Information pérenne
Chaque atelier est préparé par ses animateurs qui mettent à l'avance à disposition des participants des documents de travail. Ceux-ci seront diffusés en ligne à l'issue de l'université d'été. Les power point réalisés autour des thématiques seront mis en ligne. Les écoles thématiques du CNRS se tiennent dans des formules d’hébergement complet, de manière à favoriser l’implication et l’interaction des stagiaires et des formateurs, les rencontres et discussions, y compris en dehors des séances programmées. L’école thématique sera accueillie au Centre IGESA – Agay Roches Rouges dans le Var, où sera assuré l’hébergement des participants.
PUBLIC CONCERNE
Chercheurs, enseignants-chercheurs et ITA en linguistique (tous domaines), histoire des sciences, philosophie, informatique, psychologie, langues et lettres … Étudiants de niveau master et doctorat, français et étrangers, en : linguistique, lettres et langues, histoire des théories linguistiques, histoire, histoire des idées, philosophie…


